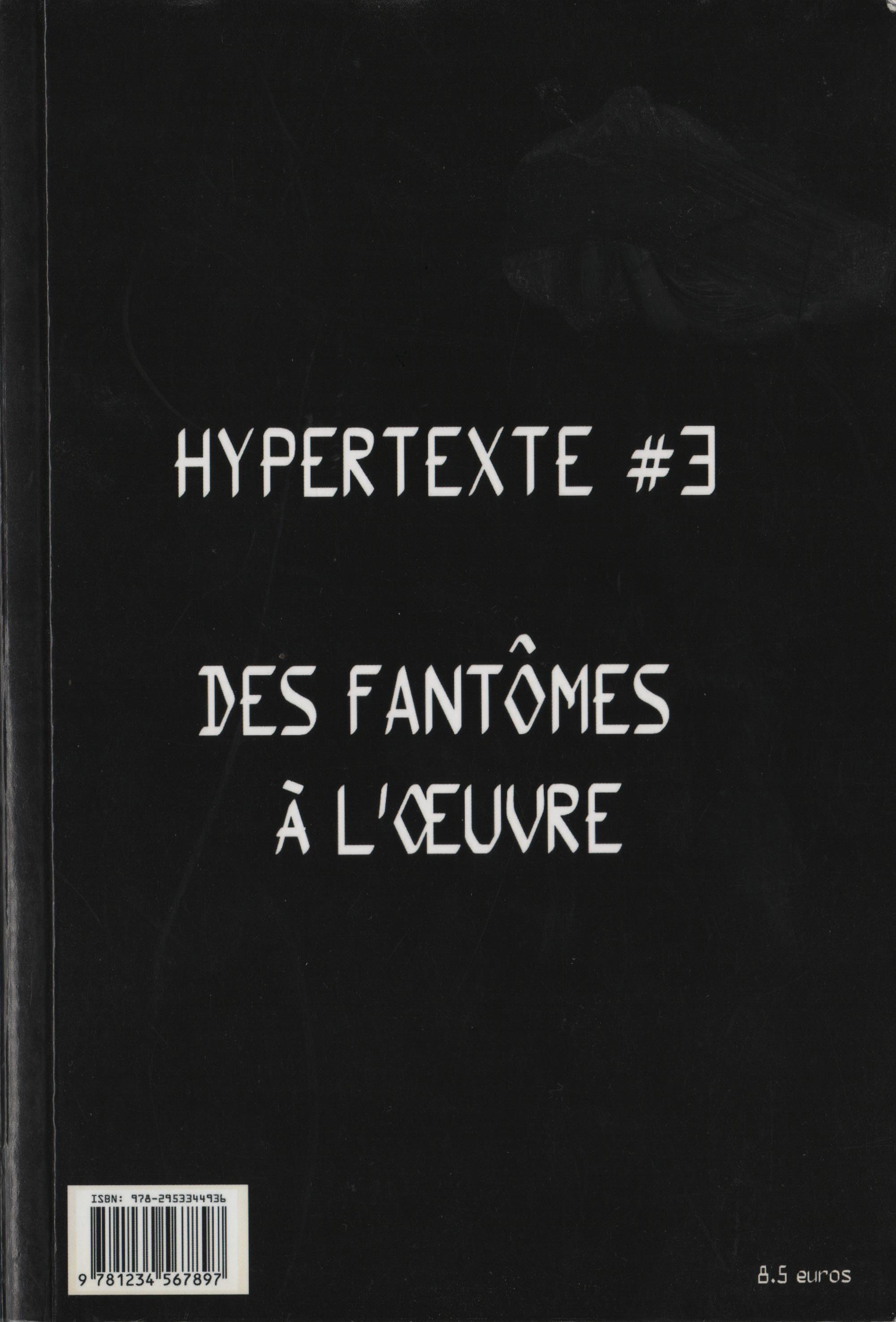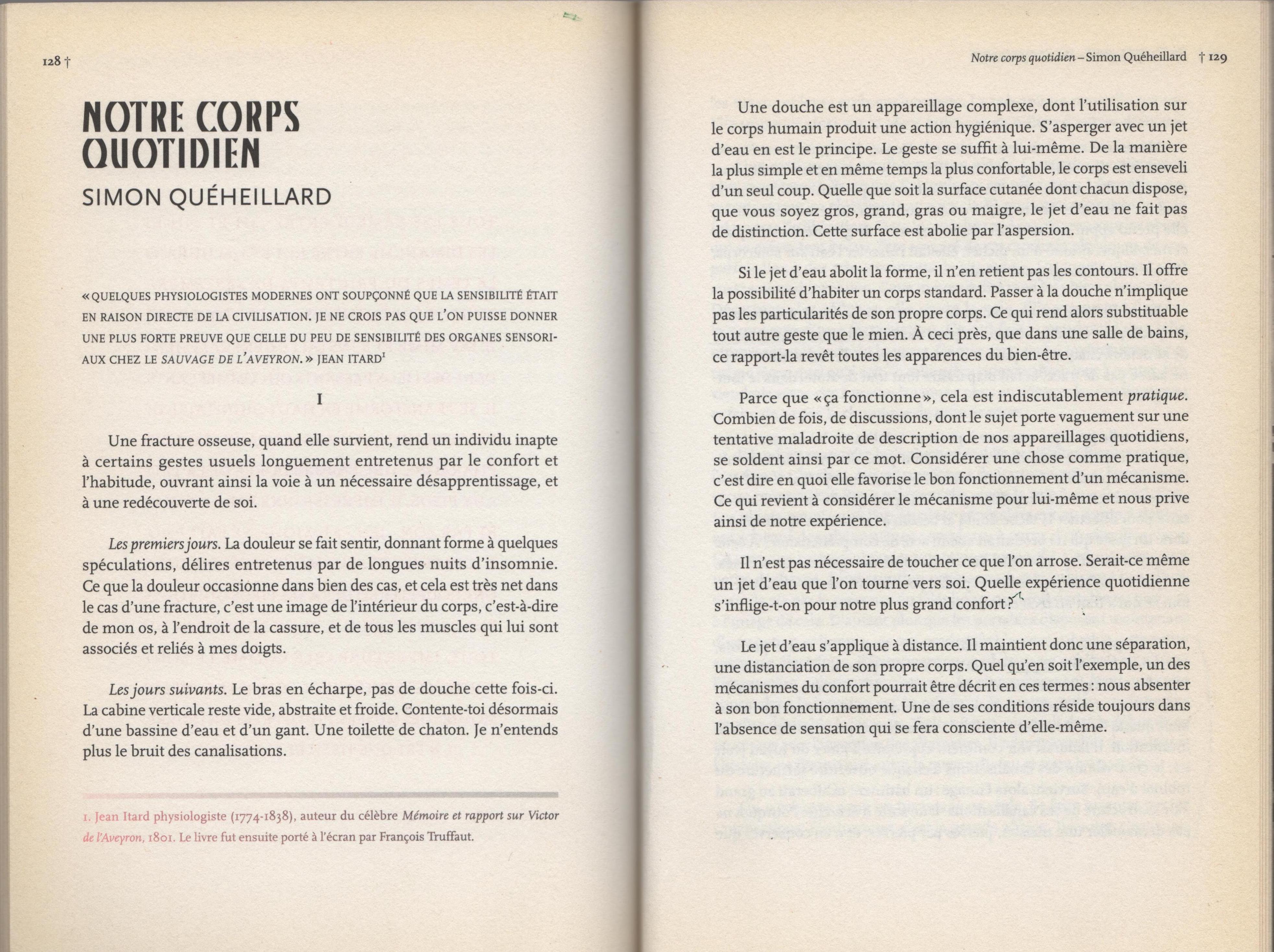« Quelques physiologistes modernes ont soupçonné que la sensibilité était en raison directe de la civilisation. Je ne crois pas que l’on puisse donner une plus forte preuve que celle du peu de sensibilité des organes sensoriaux chez le Sauvage de l’Aveyron. » Jean Itard.1
I
Une fracture osseuse, quand elle survient, rend un individu inapte à certains gestes usuels longuement entretenus par le confort et l’habitude, ouvrant ainsi la voie à un nécessaire désapprentissage, et à une redécouverte de soi.
Les premiers jours. La douleur se fait sentir, donnant forme à quelques spéculations, délires entretenus par de longues nuits d’insomnie. Ce que la douleur occasionne dans bien des cas, et cela est très net dans le cas d’une fracture, c’est une image de l’intérieur du corps, c’est-à-dire de mon os, à l’endroit de la cassure, et de tous les muscles qui lui sont associés et reliés à mes doigts.
Les jours suivants. Le bras en écharpe, pas de douche cette fois-ci. La cabine verticale reste vide, abstraite et froide. Contente-toi désormais d’une bassine d’eau et d’un gant. Une toilette de chaton. Je n’entends plus le bruit des canalisations.
Une douche est un appareillage complexe, dont l’utilisation sur le corps humain produit une action hygiénique. S’asperger avec un jet d’eau en est le principe. Le geste se suffit à lui-même. De la manière la plus simple et en même temps la plus confortable, le corps est enseveli d’un seul coup. Quelle que soit la surface cutanée dont chacun dispose, que vous soyez gros, grand, gras ou maigre, le jet d’eau ne fait pas de distinction. Cette surface est abolie par l’aspersion.
Si le jet d’eau abolit la forme, il n’en retient pas les contours. Il offre la possibilité d’habiter un corps standard. Passer à la douche n’implique pas les particularités de son propre corps. Ce qui rend alors substituable tout autre geste que le mien. À ceci près, que dans une salle de bains, ce rapport-la revêt toutes les apparences du bien-être.
Parce que « ça fonctionne », cela est indiscutablement pratique. Combien de fois, de discussions, dont le sujet porte vaguement sur une tentative maladroite de description de nos appareillages quotidiens, se soldent ainsi par ce mot. Considérer une chose comme pratique, c’est dire en quoi elle favorise le bon fonctionnement d’un mécanisme. Ce qui revient à considérer le mécanisme pour lui-même et nous prive ainsi de notre expérience.
Il n’est pas nécessaire de toucher ce que l’on arrose. Serait-ce même un jet d’eau que l’on tourne vers soi. Quelle expérience quotidienne s’inflige-t-on pour notre plus grand confort ?
Le jet d’eau s’applique à distance. Il maintient donc une séparation, une distanciation de son propre corps. Quel qu’en soit l’exemple, un des mécanismes du confort pourrait être décrit en ces termes : nous absenter à son bon fonctionnement. Une de ses conditions réside toujours dans l’absence de sensation qui se fera consciente d’elle-même.
II
Me revient en mémoire ce tableau de Degas, dépeignant une Femme à sa toilette. La scène se passe dans l’intérieur d’un appartement bourgeois, au XIXe siècle. Une femme y est accroupie dans une forme de posture primitive. Les muscles y sont sollicités. Relevant les tallons, elle prend appui sur sa main. Dans une sorte de grande bassine plate et métallique, munie d’un pichet, elle fait ruisseler l’eau sur son corps, à l’aide d’une éponge pour le bain.
Recueillir l’eau dans un récipient est aussi l’occasion d’observer tous ces petits poils et autres résidus de peau morte, dont notre corps a besoin de se défaire chaque jour pour renouveler sa peau. Prendre une douche ne laisse pas de trace, et fait disparaître tout tout de suite, dans le tout-à-l’égout.
Une telle pratique consiste à peser et à délimiter les choses. Alors que la douche me maintient au bout du tuyau, elle me rend immédiatement dépendant des canalisations. Tuyaux dont je n’ai à vrai dire aucune conscience, ni représentation. Pas plus qu’elle ne m’est nécessaire pour effectuer la tâche dont j’ai besoin à cet instant. Qu’implique donc un geste qui ne produirait aucun acte de compréhension ? À cette compréhension se substitue chez nous toute une gamme de réflexes. Simple mécanisme, opératoire et parfait pour lui-même. De ce monde-là, tout ce qui a trait au récit est absent.
L’eau prend la voie des canalisations. Et il nous arrive parfois, au travers des murs, d’y prêter l’oreille. Cela se passe dans nos maisons. Dans les murs qui nous tiennent séparés les uns des autres. Ces installations forment un réseau, un bien commun qui nous relie malgré nous. Mais quand tu te douches, si je fais la vaisselle, on peut rentrer en communication. Il faudrait voir comment apprendre à jouer du tuyau (voir ici : le choc vibrant des canalisations à chaque ouverture-ferméture du robinet d’eau). Survient alors l’image : un bâtiment exhiberait au grand jour la structure de ses canalisations. Une sorte d’écorché. Pourquoi ne pas démanteler une maison, pierres par pierres, et n’en conserver que les tuyaux et leurs embranchements. La mécanique pour elle-même. Elle trônerait ainsi sur la place publique au milieu d’autres maisons.
Une maison vide serait la maison idéale. Ce serait une pièce vide plus exactement. Parce que j’ai toujours été réfractaire à l’emprise domestique que les objets ont sur nous. Voilà pourquoi me casser le bras fut un acte de libération. Cette incapacité rend inopérants tous les objets qui se présentent à vous. Être amputé de ses capacités physiques donne parfois lieu à des retournements de situations. Les jouets cassés sont aussi source d’invention. Cette impossibilité rend les objets observables. Désarmant les réflexes, elle ouvre la voie. Elle vous rend l’accès : la promesse d’une formulation. Ce qui fait le pendant d’une telle promesse est la perte du langage. Ce que porte en lui tout traumatisme, même léger, quel qu’il soit. Si cette pièce vide venait un jour à exister, j’en viendrais assez vite à gratter les murs, pour en dégager les canalisations, et faire de ce pas la chronique de cette évasion.
Il faudrait reprendre la distinction établie par Walter Benjamin entre l’expérience du choc, qui est une forme de traumatisme, et l’expérience vécue proprement dite, en tant qu’elle ouvre la voie à une formulation. Les objets usuels que l’on attribue généralement au confort déploient souvent des phénomènes complexes à partir d’un simple « clic ». Ce principe immédiat revient quotidiennement à s’administrer une petite décharge. L’interruption permanente que subissent nos situations de vie par la présence du téléphone, qu’il soit portable ou non, est à l’image de cela. D’autant plus que les portables disposent maintenant d’une option « vibreur », ce qui rend véritablement palpable cette petite secousse électrique. Récemment, une pharmacie exhibait en vitrine l’image d’un « électrostimulateur ». Le plus surprenant étant que cette chose, dont la fonction est de raffermir le ventre, puisse maintenant paraître désirable à nos yeux. Walter Benjamin avait daté le début de ce processus avec l’invention des allumettes. Il m’arrive parfois de visualiser l’histoire de l’humanité entre la guerre du feu et mon briquet Bic.
On n’échappe pas à un tuyautage en règle. Se faire tuyauter par les canalisations. Car tuyauter, c’est la grande affaire. Tuyauter, c’est aussi d’une manière, se sentir soi-même devenir un tuyau. L’eau ruisselant le long du corps sur cette paroi qu’est la peau. Le corps est le maillon nécessaire sur la chaîne qui consiste à relier les tuyaux au tout-à-l’égout. Chaînon manquant nécessaire pour activer le réseau. Irons-nous jusqu’à assimiler ces tuyaux aux canalisations de nos tubes digestifs ? Cette approche nous en donnerait au moins une appréhension. Aussi, pourrait-on imaginer, à l’aide d’un morceau de tuyau, relier directement le robinet au siphon du lavabo. Ce raccordement ayant pour fonction de boucler les canalisations sur elles-mêmes. En pensée, nous verrions le mécanisme. Cette pensée vaudrait pour un acte de bénédiction.
Sous le flot continu, le corps est sans consistance. Il n’éprouve pas le fait de sa présence. Il y a parfois une sorte de lavement amnésique. Cela consiste en une succession de gestes, étrangers les uns aux autres, où chaque geste est affranchi du précédent. Jamais la douche ne pourra réparer la mémoire. Et il n’existe à vrai dire aucune mémoire des gestes effectués à cet instant. Walter Benjamin écrit : « Marx souligne à bon droit le caractère fluide que prend pour l’artisan la connexion entre les moments de son travail. Chez l’ouvrier d’usine, grâce au travail à la chaîne, cette connexion s’est, au contraire, durcie et réifiée ». Le propre d’une sensation est de se réfléchir elle-même. Sentir, c’est toujours sentir qu’on sent. C’est à ce compte-la qu’une sensation passe dans l’expérience, et ce en quoi elle se différenciera du choc.
III
Manger est un acte terrien, ce qui me rappelle que j’ai un corps. Comme dans certains cas la douleur, ou bien même faire du sport. Mangez, par exemple, si votre cerveau prend trop de place. Manger peut nous mettre sur la voie de la guérison. Alors contraint de vomir sous l’effet de je ne sais quel virus ou maladie, j’avais pu ressentir l’énorme puissance que représente mon estomac, cette masse musculaire dont j’étais dépossédé, et qui atteignant la limite, avait repris ses droits.
Ce « sentiment d’être terrien » est aussi conjoint au « sentiment d’être là » évoqué, non sans une certaine prudence, par l’écrivain Marcel Cohen : « Un peintre pourrait se vexer si, sommés de réagir à chaud à sa peinture, nous ne trouvions à lui dire que ce qui précède. Il aurait tort : c’est à partir de tels instants de conscience que nous nous construisons ». Ce sentiment se trouve aujourd’hui questionné dans un monde où l’expérience directe se dissout dans le virtuel et l’abstraction. Un monde où, comme le diagnostiquait déjà Walter Benjamin, « une automobile ne pèse pas plus lourd qu’un chapeau de paille, et où le fruit sur l’arbre s’arrondit aussi vite que la nacelle d’un ballon ».
Recueillir l’eau en quantité observable. Contenir la chose du regard. C’est rapporter cette masse à mon propre poids. La tenir là, face à moi. Loin des tuyaux et de la machinerie. La simple présence de cette masse me renvoie à ma propre présence. Présences conjuguées naissant de cette confrontation. La chose s’offre à vous dans la compréhension de son rapport. Je peux rapporter cette masse à la surface de ma peau. Le flot continu des canalisations est sans consistance. Que se passe-t-il lorsque le corps n’a plus de poids ?
Tracer ou délimiter la totalité du contour de votre corps, circonscrit par la peau. Munis d’un gant ou d’une éponge, comme dans le tableau de Degas. Ce geste prend l’apparence d’un dessin. Il en révèle les contours. Ils se révèlent petit à petit, comme le ferait une photographie dans un bain. La peau est une surface sensible. Plus long est le geste, car plus grande est la ligne décrite. Cette surface parcourue par la main. « Quand vous dessinez un arbre, ayez la sensation de monter avec lui. » La prophétie de nos maîtres chinois se réalise ainsi. La main dessine, la douche arrose aveuglément.
Image. C’était après un grand bain d’eau froide, un jour de forte canicule : une limite entre l’air et la peau. Chaque petite parcelle du corps perçoit alors son contour. Quand l’image survient, le corps se dessine instantanément. D’où nous dirions comme Matisse : « la naissance du [corps] dans une tête d’artiste ».
Dans son mémoire sur Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron, l’éducateur Jean Itard écrit : « c’est une chose admise pour les physiologistes que les habitants du Midi ne doivent qu’à l’action de la chaleur sur la peau cette sensibilité exquise, si supérieure à celle des hommes du Nord. J’employai ce stimulus de toutes les manières. Je lui fis donner tous les jours, et à une très haute température, un bain de deux ou trois heures, pendant lequel on lui administrait avec la même eau des douches fréquentes sur la tête ». Le but de l’opération était de lui « attendrir la chair », diminuer sa masse musculaire, en espérant que cette opération tourne au profit de sa sensibilité nerveuse, et ainsi rappeler à lui certaines sensations qu’ont occultées plusieurs années d’une vie à l’état sauvage. Toute période de convalescence ouvre la voie à une nécessaire compréhension. Entrer en convalescence : telle pourrait être la formule désignant tout acte qui conduit à l’éveil des sensations. Nous dirions là comme Le Clézio qu’ « il n’y avait pas d’art, que de la médecine ».
John Cage raconte cette expérience fondamentale. Marqué par la tentative inexorable d’éprouver le silence, il décide alors de mener cette expérience dans une pièce conçue pour l’isolation phonique. Il est dans le cas présent accompagné d’un médecin, chargé d’encadrer avec lui les conditions rigoureuses de cette expérience quasi-scientifique. En sortant de la pièce, John Cage nie y avoir perçu le silence, mais fait allusion à deux sons bien distincts, grave et aigu. Le médecin lui explique donc la cause de ce phénomène. « Le son aigu, lui dit-il, est le produit de votre système nerveux, tandis que le son grave se rapporte à votre système sanguin. » La vacuité de la pièce déclenche le système sanguin perçu comme un son extérieur à soi. La compréhension de ce rythme donne la mesure de nos expériences. Un jour, le médecin du travail m’a dit : « vous avez un cœur très lent, un coeur de sportif, et pourtant vous ne faites pas de sport ». (Il est vrai que j’avais plutôt opté pour la calligraphie chinoise, ou celle que l’on nomme le kung-fu du pinceau.) Flatté par ce compliment, j’ai répondu avoir beaucoup travaillé pour cela. À quelle vitesse le cœur bat-il devant un tableau ? Quelle modification la vitesse du cœur engendre-t-elle dans la perception ?
C’est l’histoire de la branche qui bouge. Non, c’est le vent qui bouge. Non, c’est mon cœur qui bouge.
Percevoir l’écho, ce serait l’image parfaite. Quelqu’un à l’écoute dans une pièce vide recevant l’écho de ses propres sons. Le mieux serait de ne plus bouger et d’engendrer les choses du simple fait de sa présence et son immobilité. Le regard attend une réponse. Dans la pièce vide de cette maison idéale, on perçoit le battement du cœur. Vous dégagez de la chaleur, vous êtes vivant. Comment chauffer la maison avec son propre corps ?
Simon Quéheillard